Le déchaînement du monde,
logique nouvelle de la violence
François Cusset
Editions La Découverte, 2018, 20 €
François Cusset est historien des idées, professeur à l’université de Paris-Ouest Nanterre, et l’auteur de nombreux ouvrages remarqués dont à La Découverte, French Theory (2003) et La Décennie (2006).
Un compte rendu de lecture de Sylvie Le Manchec
La violence : chacun en parle, chacun la voit, chacun la perçoit, voire l’analyse ou croit l’analyser en croyant savoir la définir.
Pourtant, François Cusset dans son ouvrage montre que ni ce qui la précède, ni ce qui lui succède n’émerge dans les analyses car le mot « violence » fait écran à tout cela. Cet aspect est d’autant plus important que la violence, qu’on croyait sinon disparue, du moins atténuée, est de retour, circulant sans cesse alors même que nos sociétés démocratiques la pensaient jugulée ; mais il n’en est rien puisqu’elle a changé de formes et de modalités, omniprésente dans notre monde actuel dont elle est selon l’auteur «le grand impensé et l’angle mort de la réflexion».
Comment définir alors le terme et pourquoi en parler ? Il s’agit d’une effraction en tant qu’atteinte à la vie physique ou/et psychique, partielle ou totale dont le viol se présente comme le paradigme. Il faut en parler puisque tout porte à voir aujourd’hui que le monde d’après les deux guerres mondiales qu’on avait voulu croire moins dur ne s’est pas mis en place, bien au contraire ; l’auteur parle à ce sujet de « violence-monde ». Pour la comprendre, il faut alors interroger l’historicité de la modernité occidentale comme « processus de civilisation » (Norbert Elias) qui aurait échoué à incorporer des normes et faire taire ses instincts et ce, d’autant plus que cette violence est passée en quelques décennies des marges de la société en son centre.
Il s’agit alors d’observer et de questionner les nouvelles modalités de la violence dont certains disent qu’il s’agit d’« une guerre civile-monde »,scène d’une démultiplication des états de violence, instiguée par la collusion entre l’Etat, les forces du marché et les forces militaro- sécuritaires. Ainsi se multiplient et s’éternisent les conflits ; de même les gouvernements « dans la violence » qui sont pourtant compatibles avec la loi du marché économique, relayés voire amplifiés par les TIC (technologies de l’information et de la communication).
En parallèle, se démultiplient aussi les instances de décision internationales, gouvernementales ou non, ainsi que les belligérants non étatiques tels que les mafias, milices, groupes terroristes…
Cette violence-monde moderne est d’abord celle d’une stricte hiérarchie planétaire entre les peuples subalternes dont les vies sont jugées sans valeur et les peuples prioritaires dont les vies doivent être protégées. En son sein sont définies le coût des morts et la valeur des vies ; ceux dont la vie est peu estimée : les Noirs, les indigènes des ex-colonies, les musulmans, autant d’hommes et de femmes constituant les migrants qui font si peur aujourd’hui alors qu’ils sont d’abord des hommes et femmes qui ont peur eux-mêmes. Il faut leur ajouter les femmes envers qui la violence augmente jusqu’à la qualifier de « féminicide ».
Mais derrière ces états de violence, F. Cusset identifie des acteurs à l’œuvre, qu’ils soient physiques ou non. Le capitalisme d’abord est violent par le rapport de forces qu’il institue entre le capital et les forces de travail qu’il soumet aux lois du marché, visant la croissance pour la croissance et la rentabilité à tout prix ; il est également violent par sa logique captatrice des richesses et des forces vives de ceux qu’il utilise pour produire.
La finance est, elle aussi, violente puisqu’elle est une arme et une forme de violence «déterritorialisée » : partout et nulle part à la fois, qui génère des effets totalement dévastateurs comme ceux qui frappent depuis 2008.
Les effets du capitalisme et de la finance sur l’humain et l’environnement sont tels que depuis la fin des années 2000, la Terre est reconnue comme « sujet de droit » par le droit international, interpelé à propos de l’ « écocide » au sens de « violence faite aux conditions de la vie sur Terre ».
L’économie serait donc aujourd’hui le principal vecteur de la violence puisqu’elle détruit la nature et le « socius » (lien social et rapport de classes traditionnel) en même temps qu’elle permet aux « nouveaux despotes » d’accéder au pouvoir et de justifier les vies sacrifiées pour y parvenir et les y maintenir.
Pour autant, la seule économie ne saurait exercer sa violence en dehors d’un système qui lui- même est garanti, voire entretenu par l’Etat qui utilise de plus en plus la rentabilité et le management comme préceptes de bonne gestion ; s’y trouvent violemment confrontées aujourd’hui les structures médicales, celles de l’Éducation ainsi que celles de la justice. L’auteur n’hésite pas à ce propos à qualifier le management « d’acte et de discours littéral de la guerre » puisque l’évaluation guette sans cesse tout un chacun dès lors qu’il a un emploi, une fonction, en en subissant sans cesse la coercition insidieuse mais néanmoins permanente.
De fait, l’Etat aujourd’hui se déprend de sa fonction sociale pour se tourner vers la collusion avec le marché et user du droit comme d’une arme de criminalisation et de répression alors qu’il est d’abord une fonction régalienne de protection des citoyens ; l’obsession sécuritaire est en effet devenue une priorité, faisant des lois d’exception comme l’état d’urgence des lois pérennes qui entravent la démocratie, voire la mettent en danger.
F. Cusset rappelle à ce propos Pascal qui déjà affirmait : » La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». La violence est bien ici systémique qui pèse sur les vies quotidiennes et les empêche d’agir.
Tout ceci contredirait donc la thèse de Norbert Elias pour qui l’auto-répression des émotions et de la violence depuis le XVI ème siècle aurait pacifié les sociétés et permis le « processus de civilisation ». En effet, l’Etat qui a policé depuis les sociétés pour maintenir l’ordre social et politique a laissé au marché le soin de policer et civiliser les peuples mais le marché ne civilise pas les sociétés : au contraire, selon l’auteur, il les « décivilise », générant sans cesse manque, frustration et rancœur. L’État quant à lui, a conservé la police, c’est-à-dire « le monopole de la violence légitime » (M. Weber) mais il a de plus en plus de mal à exister puisque la politique est dans l’élection mais pas dans l’exercice du pouvoir en tant que tel.
Pour autant, n’y aurait-il aucune réaction possible à ces nouvelles modalités de la violence et face à ces « nouveaux sauvages » que sont certains chefs d’Etat autoritaires récemment élus?
Cusset montre le contraire : des réactions via les réseaux sociaux pour critiquer souvent violemment les institutions et leurs dysfonctionnements, le marché et les inégalités renforcées qui atteignent de plus en plus les classes moyennes en danger de déclassement, les classes populaires de paupérisation et les peuples indigènes de disparition, voire d’ “ethnicide ” ; Günter Anders parlait même dès les années 1970 de « nouvelle obsolescence de l’homme », menacé de mort par la « folie techno-industrielle ».
La réaction aurait- elle alors comme seule alternative la violence ou la non-violence ? Les années1960- 1970 ont vu nombre de factions s’engager dans la lutte armée contre les ennemis politiques et ennemis de classe, violence par la suite « interdite » car proscrite pénalement par la justice et moralement par la doctrine « antitotalitaire ».
Du coup, l’histoire de France depuis le 19-ème siècle en fut purgée de ses faits les plus violents : la répression des Communards, les guerres coloniales, etc… ainsi que de ses luttes sociales pendant que l’individualisme, « le détricotage de l’Etat social » et la culture entrepreneuriale gagnaient en force, le tout dans un climat de nouveau conformisme. Pour autant, les enclaves d’insoumission, de résistance et de subversion persistent : dans une certaine presse, un certain cinéma, une certaine musique… qui cultivent « la liberté de penser » et le désir d’émancipation.
La réaction aujourd’hui ne passe plus par l’idéologie préalablement définie mais par le territoire et le local que Naomi Klein nomme « blocadie » ou blocage par inertie, réticence, apathie, voire sabotage face à un système jugé violent pour que naisse « un nouveau devoir-être » et de « nouvelles formes de vie en rupture ». Nombreux sont les exemples de « hackers », lanceurs d’alerte, faucheurs de champs semés d’OGM… pour qui la forme de vie doit être choisie et non subie ; la question est alors non pas d’être violent ou non violent mais « d’être offensif ou inoffensif ». Se donnent aussi par exemple de plus en plus à voir la résistance et l’autodéfense des minorités sexuelles et des féministes contre leurs agresseurs et contre la justice dominante. Quand il s’agit d’émancipation, la tension est permanente entre violence et non-violence qui sont intrinsèquement liées dans une tension tant éthique qu’énergétique.
La seule issue possible pour résister à ces nouvelles modalités de la violence-monde contemporaine et sortir de « l’impuissance collective » sera donc l’action collective, pragmatique et spirituelle à la fois ; et plutôt que de parler de violence du monde, il faudra lui préférer le terme de « brutalité » mais pour la résistance active à lui opposer, il faudra sans doute en passer par « des actes ou des gestes violents ».
Sera alors rendu possible « Le déchaînement du monde comme déverrouillage de chaînes qui passe toujours par des moments de chaos faits de fureur et d’excès… pour retrouver intacte la ligne d’horizon »
Sylvie Le Manchec le 6 novembre 2018
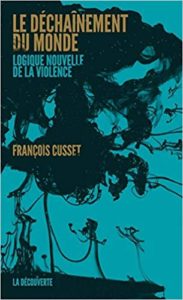

Soyez le premier à commenter